Il a fêté son centenaire en 1995, mais le cinéma a commencé très tôt – dès les années 1910 – avec l’écriture de l’histoire des techniques cinématographiques. À partir des années 1930, des synthèses abordant le cinéma du point de vue de l’art sont parues, tant aux États-Unis qu’en Europe: en France, le premier ouvrage de ce type est l’Histoire du cinéma de Robert Brasillach et Maurice Bardèche (1935). Ce mouvement se poursuit avec les sommes encyclopédiques de Georges Sadoul (à partir de 1946), de Jean Mitry (premiers tomes parus dans les années 1960), de René Jeanne et de Charles Ford, qui sont toutes, d’une manière ou d’une autre, le recueil de souvenirs de personnes ayant vécu l’évolution du cinéma depuis le début du siècle.
L’histoire du cinéma
Avec l’Histoire comparée du cinéma de Jacques Deslandes et Jacques Richard (1966-1968), une nouvelle forme d’écriture de l’histoire du cinéma est née, marquée par un retour aux sources et par la prise en compte de questions de méthode jusque-là sous-estimées. Les travaux de Deslandes et Richard se sont malheureusement arrêtés à l’étude de la production jusqu’en 1906; des historiens nord-américains et italiens ont pris la relève.
La première question que pose l’histoire du cinéma est celle de la périodisation.
La deuxième concerne la distinction des productions par pays, compte tenu des influences d’une cinématographie sur une autre et du rôle dominant du cinéma américain sur la scène mondiale – sauf en URSS et dans les pays de l’Est avant les années 1990.
Périodisation
Les critères de périodisation peuvent s’appuyer sur l’histoire politique et sociale, donc être externes au cinéma, ou bien sur les mutations propres à l’industrie cinématographique: mutations techniques, économiques ou formelles. Les périodes seront d’autant plus aisément délimitables que l’on pourra combiner les deux critères.
Du point de vue de l’histoire interne du cinéma, on peut discerner des paliers historiques à partir des phénomènes suivants: passage du court au long métrage, du cinéma muet au cinéma sonore et parlant, du noir et blanc à la couleur, de l’écran standard à l’écran large, accès de certains genres aux films à gros budget, modification de la base sociale des publics.
Ces critères combinés aux événements sociopolitiques permettent de distinguer cinq ou six périodes recouvrant, à chaque fois, de quinze à vingt années de production.
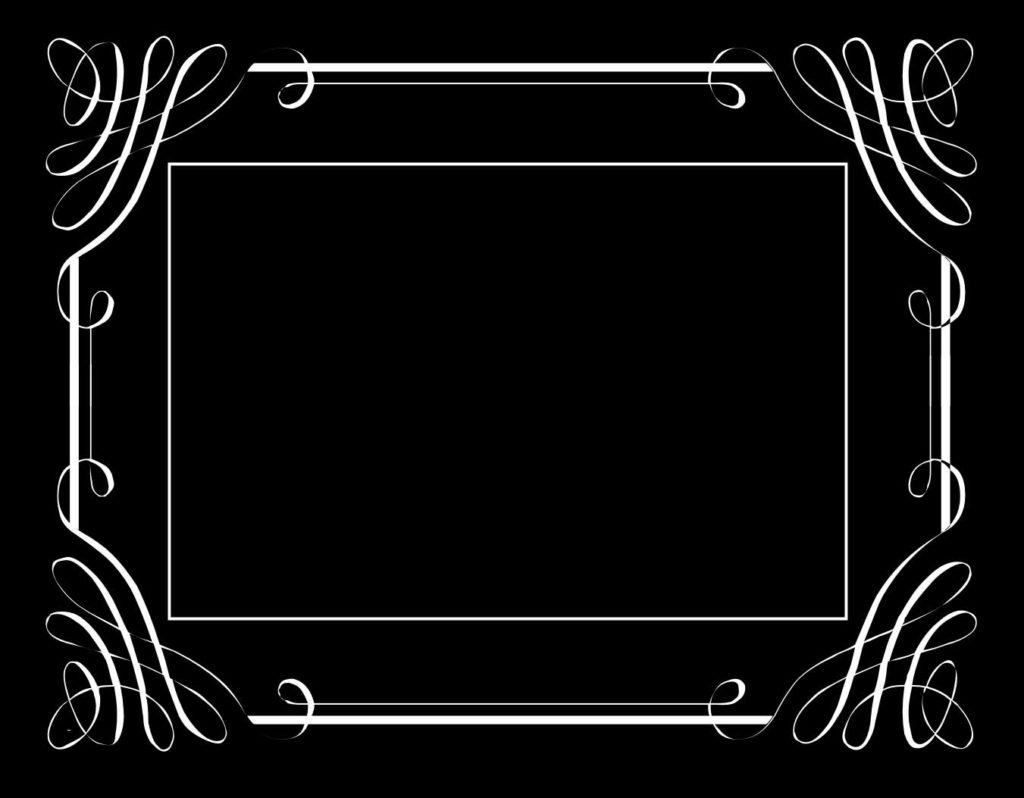
Le cinéma de 1895-1914
La période primitive s’achève avec le passage du court métrage au long métrage. Le triomphe commercial, en 1915, de Naissance d’une nation de D.W. Griffith marque le début de l’hégémonie du film de longue durée (supérieure à 80 min). Il correspond également à la modification du rapport des forces entre production française, jusqu’alors économiquement dominante, et production américaine. C’est aussi le moment où des firmes commencent à s’installer à Hollywood, qui vont se développer très vite pendant la guerre de 1914-1918. Il y a, pour cette période, coïncidence entre histoire politique et évolution économique du cinéma, la guerre ayant précipité le déclin des cinémas européens (français, mais aussi italien et scandinave).
Le cinéma de 1915-1929
La deuxième période se termine par la disparition brutale du cinéma muet, d’abord aux États-Unis, puis en Europe. À ce bouleversement technique et esthétique correspondent la crise économique de 1929 et ses répercussions en Europe, l’apparition des régimes totalitaires et les tentatives d’organisation étatique de l’industrie du cinéma, en Italie d’abord, puis en Allemagne. En France, en 1940, sous l’Occupation, est mis en place le Comité de l’organisation de l’industrie cinématographique (COIC), qui deviendra Centre national de la cinématographie (CNC) en 1946.
1930-1945
Ces quinze années voient le triomphe du modèle américain de production: c’est l’âge d’or des studios, qui se traduit par l’exportation massive des films hollywoodiens vers l’Europe et les autres continents. Bien entendu, cette exportation est brutalement interrompue par la guerre et l’occupation des pays européens par les armées allemandes. Il est donc nécessaire de distinguer l’histoire du cinéma américain, dont la période faste se prolonge jusqu’au début des années 1960, et l’évolution des autres cinématographies nationales.
1945-1960
À cette prolongation du règne américain répondent des formes minoritaires de résistance nationale: le néoréalisme en Italie, le «réalisme psychologique» en France, le réalisme socialiste en URSS. Cette période se termine par la crise des Majors hollywoodiennes et par l’affirmation de plus en plus concurrentielle, pour l’industrie du cinéma, de la télévision. Celle-ci provoquera d’ailleurs un regain d’intérêt pour le documentaire et suscitera une nouvelle esthétique au cinéma: le «cinéma direct», ou «cinéma vérité», notamment aux États-Unis (Richard Leacock), en France (Jean Rouch) et au Canada (Colin Low et Pierre Perrault).
Le cinéma de 1960-1980
Ces deux décennies sont marquées par une chute très importante de la fréquentation des salles de cinéma, dans la plupart des pays du monde. En même temps, de nouvelles formes d’écriture cinématographique apparaissent. D’abord en France, puis en Angleterre, en Italie, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, au Brésil: c’est l’explosion des «nouvelles vagues». Le cinéma cesse d’appartenir aux médias de masse, cédant la place aux télévisions. Parallèlement, la production américaine entame une lente mutation qui se concrétise au début des années 1980 par le rachat des Majors (un magnat américain du pétrole s’empare de la 20th Century Fox; Coca-Cola prend le contrôle la Columbia).
Pour lutter contre la crise, les producteurs révisent la politique qui avait été la leur depuis les débuts. En 1938, Walter Wanger avait déclaré:
«les films doivent avoir un attrait égal pour tous de 8 à 80 ans, et doivent être également divertissants pour les membres de toutes les races, de toutes les nations et de toutes les organisations religieuses, politiques et fraternelles».
Il s’agit désormais, au contraire, de cibler des publics partiels définis (telle classe sociale, telle minorité), quitte à ce que les produits, assurés d’un moindre profit, abaissent aussi leur coût de fabrication; sauf, bien sûr, périodiquement, quelques films fédérateurs.
Le cinéma depuis 1980
Durant la dernière période, c’est l’industrie électronique japonaise qui rachète les Majors (Sony s’empare de la Columbia, Matsushita de l’Universal), tandis que la production américaine se spécialise dans deux nouveaux genres: le film de science-fiction, après les triomphes de 2001: l’Odyssée de l’espace (1968), de la Guerre des étoiles (1977) et de Rencontres du troisième type (1977); et le film fantastique et d’épouvante, après les succès de Shining (1979) et d’Alien (1979).
La place nouvelle de ces deux genres, auparavant cantonnés dans les productions de série «B» (à budget moyen pour public spécialisé), indique que le cinéma américain ne cherche plus à s’adresser au public adulte, devenu principalement téléspectateur, mais qu’il entend survivre et à nouveau triompher sur les écrans du monde grâce au public des adolescents, restés gros consommateurs de films en salles. Face à la nouvelle domination du marché mondial du cinéma par les États-Unis, les industries cinématographiques extra-américaines ont de plus en plus de mal à développer leur production, voire à seulement la maintenir.

Les primitifs
Les premiers films des frères Lumière, qui durent environ une minute, montrent des scènes familiales et de vie quotidienne à Lyon; par la suite, ils présentent des images exotiques rapportées par des opérateurs des quatre coins du globe. Pendant une dizaine d’années, les vues Lumière connaissent un immense succès; elles seront imitées un peu partout dans le monde.
Edison filme des numéros de cirque pour son Kinetoscope, mais ses tentatives de mise en scène en studio tournent court. C’est Georges Méliès qui réussit le premier à intégrer la scénographie du music-hall et du théâtre de variétés à la technique cinématographique. Son Voyage dans la lune (1902) sera diffusé mondialement et, surtout, plagié par les autres firmes de production.
Pathé et Gaumont
Le développement de l’industrie française du cinéma par les frères Pathé et par Léon Gaumont s’opère grâce à la production en série de petits films comiques avec des acteurs comme Onésime, Rigadin et Boireau. Le premier grand acteur comique, Max Linder, sort de cette école: il débute chez Pathé en 1905-1906 (un titre parmi des dizaines: Max et sa belle-mère, 1910). Linder sera le modèle de Charlie Chaplin, de même que la production Pathé servira de référence à Mack Sennett lorsque celui-ci débutera à Hollywood, à la Biograph puis à la Keystone, vers 1910-1912.
La domination d’Edison
La période initiale du cinéma américain est marquée par la domination du trust contrôlé par Thomas Edison, la Motion Pictures Patent Company (MPPC), qui s’oppose à toute tentative de production indépendante. Edison voulant imposer son matériel et ses standards techniques, il s’ensuit une véritable «guerre des brevets» qui entrave la production des programmes jusqu’en 1908. C’est d’ailleurs l’une des causes du transfert de la production cinématographique de la côte est vers la côte ouest, en Californie. Deux sociétés de production implantées initialement à New York jouent un rôle actif à partir de 1908, la Vitagraph, qui lance la «Vitagraph Girl», Florence Turner, et la Biograph, où débutent D.W. Griffith (les Aventures de Dolly, 1908) et Mack Sennett. Cecil B. DeMille vient tourner à Hollywood le Mari de l’Indienne (The Squaw Man, 1911) pour la compagnie de Jesse L. Lasky. Les autres compagnies de production suivront le mouvement: la Vitagraph en 1911, l’Universal en 1912, la Fox en 1914.
Mélodrames et films à épisodes
C’est un modèle culturel européen et sérieux, l’Assassinat du duc de Guise, produit en 1908 par la firme française Film d’Art, qui va donner à Griffith l’idée d’ennoblir le mélodrame (le Remords de l’alcoolique, 1909) et d’aller chercher la caution morale de l’histoire (Naissance d’une nation, 1914; Intolérance, 1916).
La fin de cette première période est marquée par le développement du film policier à épisodes. Éclair lance en France, à partir de 1908, les Exploits de Nick Carter (réalisés par Victorin Jasset); Pathé réplique par les Mystères de New York (The Exploits of Elaine, 1914-1915), avec l’actrice Pearl White, que Louis Gasnier dirige aux États-Unis. De son côté, Léon Gaumont lance la production des séries de Fantômas (1913), des Vampires (1915), et de Judex (1916), que met en scène avec un réel bonheur le virtuose du feuilleton populaire, Louis Feuillade.
En Allemagne, un jeune cinéaste débutant à la Decla Films, Fritz Lang, fait ses armes en réalisant lui aussi des films policiers à épisodes: les Araignées (1920), le Docteur Mabuse (1922).
Autres expériences européennes
Parallèlement, le Danemark développe la première production cinématographique nationale d’une réelle ambition intellectuelle, en lien avec la richesse de l’art dramatique local. Asta Nielsen, première «star» du cinéma scandinave, apparaît dans les films d’Urban Gad (l’Abîme, 1910; la Danse de mort, 1912).
Pour leur part, les Italiens exploitent les ressources de leur tradition spectaculaire pour mettre en scène, dans un décor digne de l’opéra, des «divas» comme Lydia Borelli (Ma l’amor mio non muore, de Mario Caserini, 1913) et Francesca Bertini, et pour réaliser de grandes fresques antiques que les Américains imiteront bientôt: les Derniers Jours de Pompéi (Luigi Maggi, 1909, et seconde version de Mario Caserini, 1913); et surtout le prestigieux Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914), sur un scénario de Gabriele D’Annunzio.

L’âge d’or du muet
Les années 1920, qui se terminent avec le passage au parlant – en 1927 aux États-Unis, et un peu plus tard dans les autres pays –, se caractérisent par deux phénomènes contradictoires. D’une part, la mise en place à Hollywood, par les grandes compagnies naissantes, d’un type de production donnant lieu à une «grande forme narrative», qui deviendra un modèle international et triomphera jusqu’aux années 1950 (et qui règne encore aujourd’hui, certes sous une forme abâtardie, dans tous les téléfilms). D’autre part, l’explosion d’écoles nationales très diverses, qui s’inscrivent en dehors de cette norme narrative. En Allemagne, ce sera le courant expressionniste issu du Cabinet du docteur Caligari
(Robert Wiene, 1920); en France, l’école dite «impressionniste», autour de Louis Delluc, d’Abel Gance et de Jean Epstein; en URSS, le cinéma fondé sur la prédominance du montage, avec les films de Dziga Vertov (les reportages de Kino Pravda, 1922-1925), de S.M. Eisenstein (le Cuirassé Potemkine, 1926; Octobre, 1927), de Vsevolod Poudovkine (la Mère , 1926; la Fin de Saint-Pétersbourg, 1927) et d’Alexandre Dovjenko (Arsenal, 1929; la Terre, 1930).
Hollywood
Le modèle américain ne s’impose pas tout seul. L’histoire des studios est jalonnée de conflits entre le système de production initial, où prédomine le réalisateur (D.W. Griffith, puis Erich von Stroheim, Cecil B. deMille et Josef von Sternberg), et le système contrôlé par le directeur de studio et le producteur exécutif (Irving Thalberg, Louis B. Mayer, Adolph Zukor, Carl Laemmle, les frères Warner). La lutte qui oppose Erich von Stroheim au producteur Irving Thalberg pour le contrôle du montage définitif des Rapaces (1923) peut être considérée comme le point culminant de cet affrontement. Elle s’achève d’ailleurs par l’éviction du réalisateur, considéré comme mégalomane, en 1928. Chassé des studios, Stroheim ne pourra plus réaliser qu’un seul film sonore, de commande, au début des années 1930.
Le système hollywoodien va de pair avec la définition stricte d’un type de production fondé sur des hiérarchies budgétaires («série A», «série B») et le cloisonnement en genres et, bien entendu, sur le culte de la star, attachée au studio par un contrat très coercitif (le star system). La spécialisation des firmes selon des genres déterminés se fera après le passage au parlant: l’Universal avec les films fantastiques, la Metro-Goldwyn-Mayer avec les mélodrames historiques, la Warner avec les policiers et les comédies musicales.
Aux côtés de D.W. Griffith et de Cecil B. deMille, déjà évoqués, l’autre réalisateur de premier plan pour les années 1920, d’origine américaine, est King Vidor (la Grande Parade, 1925; la Foule , 1928).
La force de Hollywood est d’avoir attiré dès le début les réalisateurs et les acteurs européens les plus brillants: outre Stroheim et Sternberg, tous deux d’origine autrichienne et qui ont débuté leur carrière aux États-Unis, Hollywood accueille à partir de 1921 les Allemands Ernst Lubitsch et Friedrich Wilhelm Murnau, les Suédois Victor Sjöström, Mauritz Stiller et Greta Garbo.
À Hollywood, cependant, les années 1920 sont l’âge d’or du burlesque, genre qui va assurer le triomphe du cinéma américain sur les écrans du monde avec Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd et Harry Langdon. Le parlant sera malheureusement fatal à la plupart des auteurs comiques, à l’exception de Chaplin, de Laurel et Hardy et des frères Marx.
Les cinémas européens
Le cinéma allemand présente un visage nettement moins riant. Le courant expressionniste lancé par le Cabinet du docteur Caligari (1920) et, plus encore, par De l’aube à minuit (K.H. Martin, 1920) aura une grande influence hors d’Allemagne, mais il s’oppose aux tendances plus réalistes qui dominent alors la production nationale (les chroniques sociales de G.W. Pabst, notamment la Rue sans joie [1925], Loulou et le Journal d’une fille perdue [1929], avec Louise Brooks).
Le cinéma français, sous l’impulsion de Louis Delluc, s’efforce de développer une production intellectuellement ambitieuse où s’illustrent des réalisateurs comme Abel Gance, Marcel L’Herbier, Germaine Dulac et Jean Esptein. Les historiens ont qualifié ce courant esthétique d’«impressionniste» pour l’opposer un peu mécaniquement à l’expressionnisme allemand. Il n’a en effet qu’un très lointain rapport avec l’impressionnisme pictural, historiquement bien antérieur. Sa principale caractéristique esthétique est de privilégier la plastique de l’image et le rythme; il cherche également à approfondir l’étude psychologique des personnages, surtout chez Germaine Dulac (la Souriante Mme Deudet, 1923) et Jean Epstein (l’Auberge rouge, 1923; la Chute de la maison Usher, 1928).
En effet, c’est plutôt le style épique et le montage court et paroxystique qu’Abel Gance développe dans la Roue (1923) et Napoléon (1927).
Ce même montage est au centre des préoccupations des cinéastes soviétiques des années 1920, qui considèrent ce moment de la création cinématographique comme le plus important et le plus spécifique. Curieusement, ces recherches de montage trouvent leur origine dans Intolérance (film de 1916), de D.W. Griffith, dont le récit très audacieux, alternant quatre histoires montées en parallèle, n’aura pas de véritable postérité hollywoodienne. Les réalisateurs soviétiques, presque tous favorables à la révolution d’Octobre et à l’idéologie des bolcheviks, entendent faire table rase de l’art antérieur, décrété «bourgeois», et promouvoir un cinéma révolutionnaire de tendance épique, éloigné du modèle romanesque et de l’analyse psychologique.
Le Cuirassé Potemkine (film réalisé le 1925), de S.M. Eisenstein, qui illustre par excellence ce genre, aura un très grand retentissement mondial; il servira de référence au Danois Carl Dreyer pour sa Passion de Jeanne d’Arc (1928), et à toute l’avant-garde européenne de la fin des années 1920: Luis Buñuel pour Un chien andalou (1928), Jean Vigo pour Zéro de conduite (1932).

Le parlant et les années 1930
Les techniques sonores, qui avaient été testées dès les origines de l’invention, ne sont exploitées qu’à partir d’une certaine crise de la fréquentation, au début des années 1920. C’est la firme des frères Warner, créée en 1913 et restructurée en 1923, qui se lance dans l’aventure avec une audace qui se révélera très payante: d’abord avec Don Juan (1926), où l’on a simplement ajouté une musique synchronisée à la bande image, puis avec le Chanteur de jazz (1927), véritablement parlant; ces deux films d’Alan Crosland apportent de fabuleux bénéfices et dévaluent d’emblée les films muets, jusqu’alors unanimement admirés.
Partout dans le monde, les expériences artistiques les plus audacieuses connaissent un coup d’arrêt; les années 1930 se signalent par le retour à un certain réalisme de la représentation. Ce réalisme s’épanouit particulièrement – sous une forme certes très conventionnelle – dans l’ensemble de la production américaine, à l’intérieur de genres définis avec des limites assez strictes, et dans le cadre de production des studios.
Le triomphe de Hollywood
La firme Warner, dont les premiers succès commerciaux ont été des films musicaux, se distingue par la production d’une série d’œuvres policières à forte résonance sociale représentant les laissés-pour-compte de la crise de 1929: Je suis un évadé, de Mervyn Le Roy (1932), les Anges aux figures sales, de Michael Curtiz (1938). D’autres productions manifestent la même inspiration, comme le célèbre Scarface (1932) de Howard Hawks, produit par Howard Hughes. Dans le contexte d’insécurité et d’angoisse que provoquent le chômage et la délinquance urbaine, typiques de la grande dépression aux États-Unis, les films fantastiques et d’épouvante connaissent un extraordinaire succès, tel le célèbre King Kong (par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsak, 1933), dont la séquence initiale représente précisément une jeune fille affamée volant une pomme à l’étalage.
La crise de 1929, puis les réformes (le New Deal) lancées par le président Roosevelt trouvent également des échos dans les scénarios de King Vidor (Notre pain quotidien, 1934) et de John Ford (les Raisins de la colère, 1940).
La fin de la décennie est caractérisée par l’accès d’un genre jusqu’ici limité aux séries «B», le western, au premier rang de la production, grâce au succès imprévu de la Chevauchée fantastique, que réalise John Ford en 1939, après une série de films historiques aux sujets prestigieux (Je n’ai pas tué Lincoln, 1936; Marie Stuarts, 1936). Le genre western règne désormais pour trois décennies, jusqu’à la fin des années 1960, où il sera parodié – les westerns «spaghetti» – par la production italienne (Pour une poignée de dollars, Sergio Leone, 1964). Il ne survit aujourd’hui que par un titre ou deux par an, entretenant la nostalgie du genre.
Cependant, Hollywood a bien mérité son surnom d’«usine à rêves»: aux sombres inquiétudes de la décennie elle oppose les échos joyeux du film musical, qui triomphe avec Fred Astaire et Ginger Rogers (la Joyeuse Divorcée, 1934; les Ailes de la danse, 1936), et la comédie loufoque trépidante, typiquement américaine (screwball comedy), avec les meilleurs films de Frank Capra (New York-Miami, 1934; Vous ne l’emporterez pas avec vous, 1938), de George Cukor (Indiscrétions, 1940) et de Howard Hawks (l’Impossible Monsieur Bébé, 1938).
La production française
La période 1929-1939 est également favorable aux ambitions artistiques du cinéma français. Après une période difficile de transition technique entre le muet et le parlant, qui se prolonge jusqu’en 1934, le cinéma français va connaître pendant six années, jusqu’à la guerre, une situation paradoxale marquée à la fois par la crise économique de la production – on note d’innombrables faillites de sociétés – et par l’apparition de plusieurs dizaines d’œuvres de référence.
Les premières années sont dominées par les fortes personnalités de Jacques Feyder et de René Clair. Feyder revient à Paris, après quelques années passées à Hollywood, où il a pu diriger Greta Garbo dans le Baiser (1929), et réalise trois longs métrages – le Grand Jeu (1934), Pension Mimosa (1935) et la Kermesse héroïque (1935) – qui auront une influence déterminante sur la décennie en lançant la mode du film colonial, l’inspiration «réaliste poétique» et la grande fresque historique à costumes, triomphe d’une certaine esthétique des studios. René Clair, après deux longs métrages très populaires (Sous les toits de Paris , 1930, et le Million, 1931), subit l’échec public de Quatorze Juillet (1933) et plus encore du Dernier Milliardaire (1934); il s’expatrie alors, d’abord en Angleterre, puis aux États-Unis, où il restera jusqu’en 1946.
Ce début de décennie est également traversé par la carrière aussi brève que fulgurante de Jean Vigo (Zéro de conduite, 1932; l’Atalante, 1934).
Mais à partir de 1934, Marcel Pagnol (Angèle, 1934), Sacha Guitry (le Roman d’un tricheur, 1936), Julien Duvivier (la Belle Équipe, 1936), Jean Renoir (la Grande Illusion , 1937; la Bête humaine , 1938), Jean Grémillon (Gueule d’amour , 1937), Marcel Carné (Quai des brumes , 1938; Le jour se lève , 1939), associés aux scénaristes ou dialoguistes Jacques Prévert, Charles Spaak, Henri Jeanson et Jean Aurenche, réalisent des films qui deviendront autant de classiques du cinéma national. La décennie se clôt sur le chef-d’œuvre de Renoir, la Règle du jeu
(1939). Qualifié de «poétique», le réalisme de cette école française se caractérise par l’atmosphère souvent morbide des scénarios et des thèmes, transfigurée par un travail plastique sur l’image et la lumière, et par des dialogues à la fois populaires et lyriques; ce courant se prolongera jusqu’à l’après-guerre avec les Portes de la nuit (1946), de Carné et Prévert.
La production française des années 1930 acquiert un prestige international considérable. Les Américains achètent les droits des scénarios pour réaliser des remakes adaptés à leur public avec des acteurs connus outre-Atlantique; ainsi, la Chienne de Renoir (1931) devient Scarlet Street (Fritz Lang, 1945), Pépé le Moko de Duvivier (1937) devient Casbah (John Cromwell, 1938), Le jour se lève de Carné (1939) devient The Long Night (Anatole Litvak, 1947).
Le réalisme des Renoir, Duvivier, Carné, Grémillon, lié à l’atmosphère populiste de la période du Front populaire, servira également de référence esthétique et morale aux théoriciens, scénaristes et futurs réalisateurs italiens (notamment Luchino Visconti, ancien assistant de Jean Renoir), qui découvrent les films français et les analysent au Centre expérimental de la cinématographie de Rome, pourtant créé par les responsables culturels du régime fasciste.
Hitchcock
Le cinéma européen de cette période est également marqué par la forte personnalité d’un réalisateur anglais, Alfred Hitchcock. La réputation de son œuvre (les Trente-Neuf Marches, 1935; Une femme disparaît, 1935) franchit rapidement les frontières: il vient à Hollywood en 1939, à l’appel de Selznick, pour réaliser une adaptation de Daphné Du Maurier, Rebecca (1940).

Cinéma de guerre et cinéma totalitaire
Dès l’entrée en guerre des États-Unis (après l’attaque de Pearl Harbor), l’usine hollywoodienne s’associe à l’ensemble de l’appareil industriel américain pour défendre les valeurs de la démocratie occidentale contre les régimes nazi et fasciste et l’impérialisme nippon. Frank Capra produit la série Pourquoi nous combattons (1942-1945), les émigrés européens réalisent des films dénonçant le nazisme: Charlie Chaplin (le Dictateur , 1940), Alfred Hitchcock (Correspondant 17, 1940; Lifeboat, 1944), Fritz Lang (Chasse à l’homme, 1941; Les bourreaux meurent aussi, 1943), Ernst Lubitsch (To Be or Not to Be, 1942), Michael Curtiz (Casablanca, 1943).
Le premier long métrage d’un réalisateur débutant venu du théâtre d’avant-garde et de la radio, Orson Welles, réalisé en 1941, avec une liberté exceptionnelle, pour la compagnie RKO, Citizen Kane , marque un tournant esthétique fondamental dans l’histoire du cinéma américain. Toutefois, son insuccès public et l’accueil mitigé que lui réserve la critique dans son pays ne lui permettent pas d’avoir une influence immédiate. En outre, la liberté de création dont a bénéficié Orson Welles a eu la chance de trouver pour Citizen Kane lui coûtera cher: il ne pourra plus jamais contrôler le montage de ses films à Hollywood et devra s’expatrier en Europe.
En France, de 1940 à 1944, l’Occupation provoque une situation exceptionnelle: la concurrence américaine a pratiquement disparu des écrans, et la part des films autorisés venant d’Allemagne ou des autres pays reste assez minoritaire. Les nombreux départs et interdictions professionnelles suscités par les mesures politiques et raciales de Vichy provoquent un renouvellement des générations. La fréquentation des salles atteint par ailleurs des chiffres records. Malgré les mécanismes de censure directe et d’autocensure, ces quelques années voient donc la réalisation d’œuvres majeures, comme celles de Marcel Carné associé à Jacques Prévert (les Visiteurs du soir, 1942; les Enfants du paradis , 1945), de Henri-Georges Clouzot (L’assassin habite au 21, 1942; le Corbeau , 1943), de Jean Grémillon (Lumière d’été, 1942; Le ciel est à vous, 1943), de Robert Bresson (les Dames du bois de Boulogne, 1944).
En Allemagne, le cinéma nazi produit le Jeune Hitlérien Quex (Hans Steinhoff, 1933), le Triomphe de la volonté (Leni Riefenstahl, 1935) et le Juif Süss (Veit Harlan, 1940). Le cinéma italien s’efforce de glorifier la mythologie fasciste avec la Couronne de fer (Alessandro Blasetti, 1941). Le cinéma soviétique abandonne les recherches d’écriture des années 1920 et, sous l’œil vigilant de Joseph Staline, adopte la doctrine du héros positif et du réalisme socialiste édictée par Jdanov (Tchapaïev, G. et S. Vassiliev, 1934). S.M. Eisenstein abandonne le montage du Pré de Béjine (1936) et se soumet à la propagande nationaliste avec Alexandre Nevski (1938), avant d’offrir un testament shakespearien dont la seconde partie sera censurée jusqu’en 1958 (Ivan le Terrible , 1942-1946).

L’après-guerre et les années 1950
Tandis que Hollywood poursuit sur sa lancée brillante et toute d’artifice, l’Europe se relève lentement de ses ruines avec, de plus en plus, l’exigence du réel.
Mouvement majeur de l’histoire du cinéma, le néoréalisme apparaît sur les écrans italiens de la Libération. Il est lancé par quelques œuvres clés: les Amants diaboliques (Luchino Visconti, 1942), Rome, ville ouverte et Paisà (Roberto Rossellini, 1945 et 1946), le Voleur de bicyclette (Vittorio De Sica, 1948) et des films moins connus mais tout aussi décisifs comme Chasse tragique et Riz amer (Giuseppe De Santis, 1948) ou Umberto D (Vittorio De Sica, 1951).
Après le succès des superproductions historiques et des mélodrames des années 1910-1914, véritables matrices de l’imaginaire mussolinien, le cinéma italien n’avait plus donné de réalisations remarquables. Le néoréalisme propose une esthétique du réveil brutal face à la réalité des ruines. Avec lui, le cinéma repart de zéro; il renoue avec le tournage en extérieurs du début du siècle, abandonne le décor et les acteurs professionnels, redécouvre sa fonction documentaire.
L’éternelle «usine à rêves»
Bien entendu, pendant ce temps, la machine hollywoodienne du cinéma américain continue à tourner à plein régime et à inonder le marché mondial du stock inépuisé des films non distribués en Europe au début des années 1940. Jusqu’à la crise des Majors, au début des années 1960, Hollywood connaît une période de production extrêmement faste, favorisée par une relève de génération. Apparaissent alors des auteurs majeurs, qui renouvellent la plupart des grands genres hollywoodiens, comme le western, le mélodrame, le policier ou le film de guerre: Nicholas Ray (la Fureur de vivre, 1955); Anthony Mann (l’Appât, 1953); Richard Brooks (Elmer Gantry le Charlatan, 1960); Samuel Fuller (le Jugement des flèches, 1957); Elia Kazan (Sur les quais , 1954); Joseph L. Mankiewicz (la Comtesse aux pieds nus, 1954); Robert Aldrich (Attaque, 1956); Vincente Minnelli (Celui par qui le scandale arrive, 1960).
Le cinéma d’auteur à l’européenne
Parallèlement, un peu partout en Europe, un cinéma d’auteur tente – non sans difficultés – de s’affirmer en dehors des genres, des écoles, et surtout des contraintes de production et de commercialisation. La carrière du réalisateur danois C. Dreyer apparaît exemplaire à cet égard: d’une morale artistique intransigeante, il ne peut, face aux contraintes commerciales du cinéma sonore – et alors qu’il avait mis en scène une dizaine de longs métrages muets dans les années 1920 –, réaliser que quatre longs métrages (et quelques courts métrages de commande) entre 1932 et 1968, date de sa mort. Tous constituent des jalons décisifs dans l’évolution esthétique du septième art: Vampyr (1932), Dies irae (1943), Ordet (1955) et Gertrud (1964).
Au sein de la production française des années 1950, seul Robert Bresson exprime une ambition esthétique et morale aussi haute, avec les Dames du bois de Boulogne (1944) et plus encore avec Un condamné à mort s’est échappé (1956) et Pickpocket (1959).
Une semblable rigueur artistique se retrouve, à des degrés divers en raison des contraintes de production qui pèsent sur chacun de leurs films, dans l’œuvre de cinéastes aussi personnels que Michelangelo Antonioni (le Cri, 1957; l’Avventura , 1960), Luchino Visconti (Senso, 1954; Rocco et ses frères, 1960), Federico Fellini (La dolce vita , 1960), Luis Buñuel (Él, 1952; Nazarin, 1958), et bien sûr Ingmar Bergman (la Nuit des forains, 1953; le Septième Sceau, 1956). Tous ces cinéastes sont les auteurs de référence du cinéma «d’art et d’essai», reconnu par un label particulier et doté d’un réseau de salles spécifique de l’exploitation cinématographique française. Leur œuvre, qui s’affirme dans les années 1950, se prolonge pour la plupart bien au-delà, jusque dans les années 1970 et 1980.
Les «nouvelles vagues»
C’est, paradoxalement, de la confrontation entre la production la plus standardisée de Hollywood et le radicalisme du néoréalisme italien que vont naître la Nouvelle Vague française (1958-1962) et, derrière elle, toute une série de cinématographies en rupture violente avec les écoles du passé. La nouvelle vague s’élève contre l’académisme, les scénarios conventionnels; elle revendique une nouvelle écriture cinématographique, «libérée de la machinerie des studios et du souci de la perfection technique» (John Cassavetes); elle est à l’origine du mouvement mondial des nouveaux cinémas, qui se déploie de Paris à Rome en passant par Rio de Janeiro, Budapest, Prague, Varsovie. Tous les jeunes cinéastes du monde se réclament d’une vision neuve de la réalité sociale: Alain Resnais dans Hiroshima mon amour (1959), François Truffaut dans les Quatre Cents Coups (1959), Jean-Luc Godard dans À bout de souffle (1959), le Brésilien Glaúber Rocha (le Dieu noir et le Diable blond, 1964), les Tchèques Milos Forman (l’As de pique, 1964) et Vera Chytilova (les Petites Marguerites, 1966), le Polonais Jerzy Skolimowski (Walkover, 1965).
Dans le même temps, le Free Cinema anglais (Samedi soir et Dimanche matin, Karel Reisz, 1960), le «cinéma direct» new-yorkais (Shadows, John Cassavetes, 1960) et, quelque temps plus tard, québécois (Pour la suite du monde, Pierre Perrault, 1963) témoignent du même retour subversif à la réalité sociale.

De la Nouvelle Vague au nouveau souffle
Tandis que, au long des années 1960, les «nouvelles vagues» déferlent encore en Tchécoslovaquie, au Brésil ou en Grande-Bretagne, les jeunes cinéastes français se reclassent dès 1962, rejoignant qui la télévision (Godard), qui la mise en scène classique (Truffaut, Chabrol).
Hollywood en crise
Les années 1960 sont le temps d’une crise grave pour le système de production américain, atteint de sclérose esthétique. La plupart des créateurs originaux apparus dans les années 1950 perdent leur talent dans des superproductions qu’ils ne peuvent maîtriser. Ainsi Anthony Mann (les Héros de Telemark, 1965), Nicholas Ray (les Cinquante-Cinq Jours de Pékin, 1962) et, dans une moindre mesure, Joseph Mankiewicz (Cléopâtre, 1963). Les réalisateurs Robert Aldrich, Billy Wilder, Elia Kazan, Otto Preminger tentent bien d’acquérir une certaine liberté en choisissant le statut de réalisateur-producteur, mais ils n’y parviennent pas toujours.
Par ailleurs, les Européens – notamment les Italiens pour les westerns –, les Japonais, les Chinois de Hongkong (films de kung-fu) viennent concurrencer Hollywood sur son propre terrain avec des films populaires à très bas prix.
Après une décennie de tâtonnements, Hollywood trouve la parade: produire des films à gros budget qui multiplient les effets spéciaux. En ce sens, 2001 : l’Odyssée de l’espace, réalisé par Stanley Kubrick en 1967, annonce la production des années 1970 et 1980. Le réalisateur qui fait la transition avec la génération suivante est Francis Ford Coppola : son œuvre témoigne d’abord d’une certaine continuité à l’égard du classicisme hollywoodien (le Parrain, 1972; Conversation secrète, 1974), avant de prendre, à partir d’Apocalypse Now (1979), une allure plus moderniste, où décors et mise en scène évoquent l’opéra.
La reconversion des studios américains
Au cours des années 1970, une nouvelle génération de scénaristes, de producteurs et de réalisateurs, issus pour la plupart des universités américaines, met à profit son savoir-faire et sa connaissance des vieilles recettes spectaculaires pour moderniser des genres quelque peu tombés en désuétude. Avec sa trilogie de la Guerre des étoiles (1977), George Lucas donne un cadre de science-fiction à la légende médiévale de la quête du Graal; Steven Spielberg renouvelle les ficelles du film fantastique (Duel, 1971; les Dents de la mer, 1975) et de l’anticipation des années 1950 (Rencontres du troisième type, 1977; E.T., l’Extraterrestre, 1982). L’esprit d’enfance des studios de Walt Disney irrigue l’ensemble de la production, même de manière parodique (Gremlins, Joe Dante, 1984).
Dans la Nuit des morts vivants (George Romero, 1968) ou dans Massacre à la tronçonneuse (Tod Hooper, 1974), les scénaristes ont actualisé les archétypes terrifiants des ogres sanguinaires et des sorcières diaboliques proposés jadis aux adolescents par les contes de Grimm et de Charles Perrault. Batman (Tim Burton, 1989), remake d’un feuilleton télévisé des années 1940, fera l’une des plus grosses recettes de l’histoire de Hollywood et suscitera une véritable «batmania».
Du cinéma à l’industrie de loisirs
Au cours des années 1980, l’industrie des spectacles se mondialise, avec un partage des secteurs. Les entreprises japonaises contrôlent désormais les grandes firmes de production et, par le biais du matériel électronique grand public, les moyens de diffusion vidéographiques et télévisés. Hollywood et ses nouveaux producteurs (Lucas, Spielberg, Coppola) monopolisent les industries de programme. Ainsi, les films américains cumulent les recettes dans la plupart des pays du monde, leur part du marché dépassant pour la première fois en France, au début des années 1990, celle des productions nationales. L’ouverture d’Euro Disneyland sur le continent, au printemps 1992, symbolise avec éclat la reconversion réussie de l’industrie nord-américaine des loisirs. C’est dans ce contexte que Steven Spielberg donne une suite aux Aventures de Peter Pan (Walt Disney, 1953): Hook (1992).
Les cinémas non occidentaux
Hollywood et l’Europe n’offrent pas les seules cinématographies de la planète. En vérité, la plupart des innovations stylistiques, esthétiques, et parfois même commerciales, des années 1970 et 1980 proviennent de cinématographies minoritaires. Mais celles-ci demeurent généralement méconnues hors de leur pays ou de leur zone d’influence géographique (Afrique, Asie, Moyen-Orient). Il est vrai que le marché de la diffusion de films aux États-Unis – pour ne donner qu’un exemple – est tel qu’il ne permet de présenter à ses spectateurs qu’à peine 2 % d’œuvres étrangères.
Aujourd’hui, ce sont les cinémas non occidentaux, présents dans les festivals internationaux, qui font connaître à l’art cinématographique une nouvelle vitalité et un certain dynamisme thématique. Parmi eux, on trouve les cinémas du Japon, de la Chine populaire, de Hong-Kong, des Philippines, des différents pays africains, ainsi que de l’Inde et de l’Égypte – ces deux derniers pays comptant parmi les plus importants producteurs mondiaux.
Image - Cartes - Photos : poster carte de france - Voyage – Carte – Plan Cartes – Géographie – Voyages
Voyage – Carte – Plan Cartes – Géographie – Voyages



